Homme de LettreS
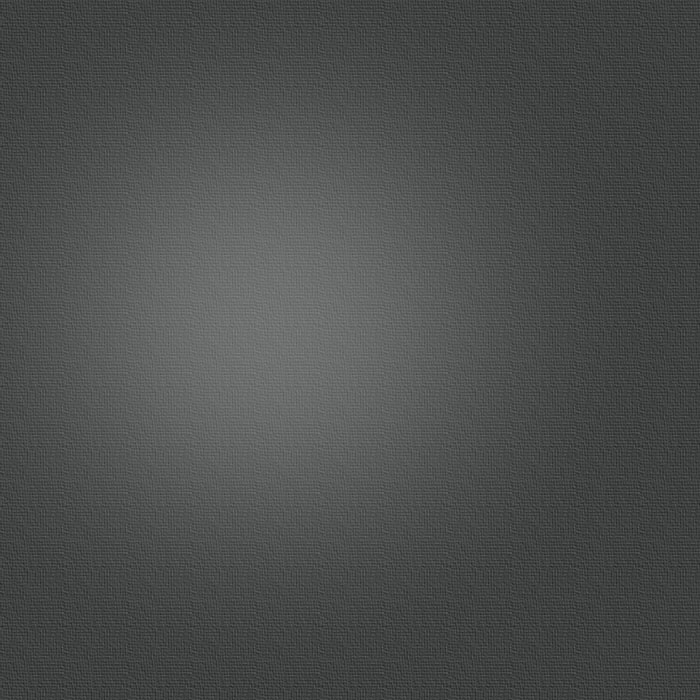
L'ÉCRIVAIN
“La littérature m'aura servi de religion”
Le 30 décembre 1982, les Orléanais apprenaient qu'ils venaient de perdre leur ancien maire, dont l'action s'inscrit si profondément dans la trame de notre ville ; les lecteurs de “La République du Centre” ne liraient plus l'éditorial où le directeur du journal leur proposait une réflexion lucide et sereine sur l'actualité sociale et politique ; mais avait-on conscience que la mort de Roger Secrétain mettait aussi, et peut-être surtout, le point final à l'œuvre d'un écrivain de vocation, de celui qui, en 1978, à l'âge de 76 ans, se confessait en écrivant : “La littérature m'aura servi de religion” ?
Il est bien certain que si, par fidélité à sa ville et à ses amis, Roger Secrétain n'avait pas délibérément décidé de rester un Orléanais, un provincial, s'il avait comme tant d'autres accepté de “monter à Paris”, il aurait occupé dans la République des lettres une place éminente.
Doué par nature d'un authentique talent d'écriture, avide de s'exprimer, de confier à la page blanche les réflexions que lui suggéraient ses lectures, le fruit de ses méditations (“cette tentation de philosophisme est ma maladie”), il fut d'abord l'analyste de ses auteurs de prédilection dans “Destins du poète” (1937), qui lui valut la bourse de la Fondation Blumenthal, et dans “Quand montait l'orage” (1946). Ses études sur Rilke, Amiel, Péguy, Gide, Barrès, Mallarmé, Nietzsche sont d'une pénétration et d'une pertinence auxquelles le temps n'a rien enlevé de leur actualité. Et l'on sait qu'Henry de Montherlant, si exigeant en ce domaine, se reconnut si bien dans les “Notes de Destins du poète” qu'il ne voulut nul autre que Roger Secrétain comme préfacier de ses œuvres romanesques dans la bibliothèque de la Pléiade…
…Ceux qui l'on plus intimement connu savent en effet quelle était l'exquise sensibilité de cet homme politique, de ce maire, de ce journaliste ; ils savent quelle complicité il entretenait avec les êtres, les objets, les œuvres d'art, la musique, la nature, les lieux familiers.
Et cette sensibilité s'exprime surtout dans ces deux poèmes en prose que sont “La Lettre à une voyageuse” (1968) et “Saint-Jean-du-Ciel”(1976) ; dans ces rêveries, ces paysages romanesques (qu'il voulut illustrés des burins de J.P. Blanchet et de L.-J. Soulas), il exprime sa “volupté qui est celle des mots”, la volupté d'une âme contemplative qui s'écrie à la fin d'un Nocturne : “Je regarde, je regarde et je frissonne de joie à la pensée que j'aurais pu mourir sans avoir assez regardé le ciel, ses mécanismes rutilants, ses énigmes, sa fourmillante inutilité, son clair désordre, et sa splendeur, sa splendeur inhumaine qui pèse sur moi comme si j'allais être écrasé par les semelles de Dieu, parsemées de clous d'or.”
En 1977, Roger Secrétain publie “Ceux qui ont éclairé nos chemins”, titre à la fois de modestie et de reconnaissance, où le septuagénaire paye en quelque sorte sa dette envers ceux qui, toute sa vie, auront été ses “compagnons de route”, ceux qu'il a connus plus familièrement (Spire, Max Jacob, Genevoix), ceux dont la pensée et l'œuvre l'ont le mieux «éclairé» dans les cheminements de la vie (Péguy, Montherlant, R.-G. Cadou), ceux-là aussi (Schumann, Chopin) dont les accents ont séduit celui qui, dans sa jeunesse, avait été lauréat de la classe de violon du Conservatoire d'Orléans.
Ces pages ont été écrites entre 1934 et 1976, mais Roger Secrétain a tenu à les revoir et les recueillir au soir de sa vie, en approfondissement de sa propre pensée, et pour une plus juste mesure de ce que chacune de ces œuvres, chacune de ces personnalités présente de “l'image de l'homme”. Lisant ces portraits, entrant dans cette critique toujours plus clairvoyante, on accompagne l'itinéraire de Roger Secrétain à travers ses lectures comme à travers l'expérience vécue, l'itinéraire d'un homme qui, après avoir tant lu et tant écrit sur ce qu'il a lu, s'écriait encore : “Je ne songe pas sans détresse à tout ce qu'en mourant je n'aurai pas lu !” )
Si l'on voulait dresser un tableau complet de l'œuvre littéraire de Roger Secrétain, il faudrait encore faire état de tant d'articles publiés dans diverses revues, il conviendrait de rappeler telles pages sur Orléans, sur Jeanne d'Arc ; mais à ceux qui voudraient mieux connaître et sa personne et le plus profond de sa pensée, on conseillera de lire avant tout le très bel essai qu'il publia en 1978 : “Sagesse du pessimisme”.
Celui qui, dans sa jeunesse, s'enthousiasmait à la lecture de Nietzsch réfléchit ici sur “les forces du destin, que d'autres appellent la dialectique de l'histoire” ; il s'interroge sur le doute, la certitude ; il s'efforce, sachant bien qu'il ne saurait y parvenir définitivement, d'analyser les “raisons” des événements qu'il a vécus ; il se demande quelle peut être une sagesse en face des “forces contradictoires qui agitent les hommes”. Agnostique, pour qui “la tentation de la foi est moins forte que celle de l'intelligence, du savoir ou du pouvoir”, Roger Secrétain, à l'école du stoïcisme antique, refuse les idéologies modernes du bonheur et confesse son désenchantement en affirmant : “Ma misanthropie n'est pas un mépris ni une réclusion, elle est seulement un scepticisme...” ; mais ce pessimisme ne saurait être un refuge dans l'abandon car “le dernier recours, au long d'une vie, surtout au déclin d'une vie, est la parole évangélique, chargée d'une terrestre sagesse : Travaille tant que tu as encore de la lumière”.
Jacques BOUDET
1984
